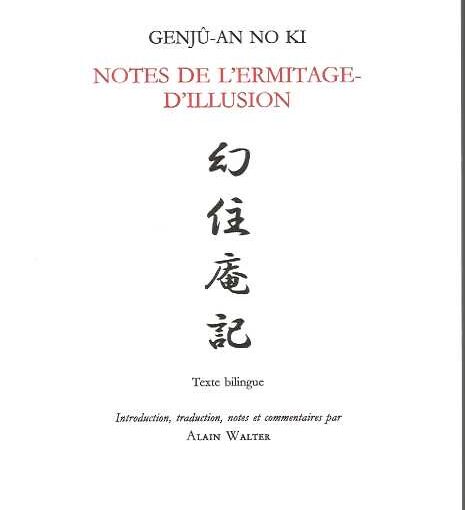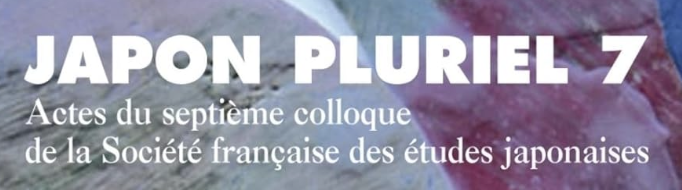Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (Umifre 19, MEAE-CNRS)
février 2024
L’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise a le plaisir de vous inviter aux événements de février. (Détails plus bas)
Mardi 13 février / 18h – 20h : Femmes en guerre (France, XVIᵉ-XVIIIᵉ siècle)
Mercredi 14 février / 18h – 20 : Un nouveau type de jardin japonais dans la France des années 1950 et 1960
Jeudi 15 février / 18h – 20h : Paysage moderne et contemporain : regards croisés entre la France et le Japon
Vendredi 16 février / 18h – 20h : Fanon : race, genre et existence humaine sous domination coloniale
Lundi 19 février / 18h – 20h : Des estampes aux jardins : quand les regards des paysagistes japonais croisent ceux des paysagistes français
Tuesday, February 20 / 12:30 – 14:00: Banking on Japan: why a sustainable future holds rich opportunities
Lundi 26 février / 18h – 20h : Routes maritimes et techniques de navigation des pirates japonais – seconde moitié du XIVᵉ – première moitié du XVᵉ siècle
Mardi 27 février / 18h – 20h : Le mécanisme du shinsho japonais en évolution – réflexion à travers l’histoire et le processus de fabrication
Mercredi 28 février / 18h – 20h : Care et travail de care : nouvelles questions au Japon et en France
Femmes en guerre (France, XVIᵉ-XVIIIᵉ siècle)
Mardi 13 février / 18h – 20h
salle 601 / conférence / en français avec traduction
Conférencière : Sylvie STEINBERG (EHESS)
Si la figure de Jeanne d’Arc est entrée très tôt dans les annales de l’histoire de France, il reste peu de traces d’autres figures de femmes en armes. Pourtant, sous l’Ancien Régime, la guerre de siège a favorisé leur participation active à la défense des villes tandis que certaines se sont engagées clandestinement dans les armées en campagnes. Exceptionnelle et transgressive, cette présence féminine dans les guerres n’en est pas moins célébrée dans les productions culturelles savantes et populaires du temps. Au moment de la Révolution française, le projet de former des bataillons féminins et de s’engager pour défendre la nation émerge comme une revendication féministe et patriotique. Chassées de l’armée en 1793, les femmes y ont tout de même une place en tant que suiveuses et cantinières. La conférence retrace l’éventail des expériences guerrières des femmes, une histoire renouvelée récemment par de nombreux travaux historiques.
Discutante : Norie TAKAZAWA (univ. Hosei)
Modératrice : Naoko SERIU (univ. des études étrangères de Tokyo)
Organisation : IFRJ-MFJ
Soutien : Société franco-japonaise des sciences historiques, JSPS KAKENHI 18K01023
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/13/2024-02-13_sylvie_steinberg_-_/
Jardins et paysages 1
Un nouveau type de jardin japonais dans la France des années 1950 et 1960
Mercredi 14 février / 18 h – 20 h
hybride : salle 601 et en ligne / conférence / en français sans traduction
Conférencière : Hiromi MATSUGI (univ. d’Ehime)
Cette conférence s’intéressera aux deux jardins japonais créés en France dans les années 1950 et 1960 : le jardin de l’UNESCO à Paris, conçu par le sculpteur américain Isamu Noguchi, ainsi que le pavillon et le jardin de thé offerts par l’école de thé Urasenke au jardin Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt. Grâce aux documents d’archives ainsi qu’aux témoignages des jardiniers qui ont participé à leurs constructions, nous retraçons l’histoire de leurs commandes reflétant la situation internationale de la guerre froide et celle de leurs conceptions marquées par une esthétique moderne. Nous verrons ainsi comment l’esthétique et la politique s’influencent mutuellement pour forger un nouveau type de jardins japonais en France, pays qui connaît le phénomène depuis la deuxième moitié du XIXᵉ siècle.
*La conférencière résumera son exposé en japonais en fin d’intervention.
Modératrice : Delphine VOMSCHEID (IFRJ-MFJ)
Organisation : IFRJ-MFJ
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/14/2024-02-14_jardins_et_paysages/
Jardins et paysages 2
Paysage moderne et contemporain :
regards croisés entre la France et le Japon
Jeudi 15 février / 18h – 20h
hybride : salle 601 et en ligne / conférence / avec traduction
Conférencières : Noriko AKITA (univ. de Chiba), Sonia KERAVEL (LAREP, ENSP)
Noriko AKITA : « Les liens entre la France et le Japon dans le domaine du paysage moderne »
Henri Martinet (1867-1936), diplômé de l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles, l’un des principaux architectes paysagistes français, a conçu le Shinjuku gyoen (1906), un grand parc au cœur du Japon. Par ailleurs, un élève de Hayato Fukuba, fondateur de l’architecture paysagère japonaise et influencé par Martinet, a conçu un jardin à la française pour la faculté d’horticulture de l’université de Chiba (1910), seule université nationale du Japon à disposer d’une faculté d’horticulture. Près de 100 ans plus tard, en 2023, la faculté d’horticulture de l’université de Chiba et l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles ont conclu pour la première fois un accord de recherche universitaire.
Sonia KERAVEL : « Croisements, inspirations : quelques regards de paysagistes français contemporains sur le Japon »
Cette intervention s’appuie sur les archives de l’IFLA (International Federation of Landscape Architects) et de quelques paysagistes français de la seconde moitié du XXᵉ siècle ayant voyagé au Japon et s’interroge sur ce qui retient l’attention des professionnels du paysage lorsqu’ils visitent l’archipel nippon. Que viennent voir les paysagistes lorsqu’ils voyagent au Japon ? Qui rencontrent-ils ? Que viennent-ils apprendre ? Et comment regardent-ils ? À travers les programmes des congrès internationaux (IFLA 1964 et 1985) et les carnets de croquis et les photographies des concepteurs (Michel Corajoud, Ingrid et Michel Bourne), nous verrons comment ces voyages peuvent nourrir et enrichir la pratique des paysagistes français et ouvrir un dialogue franco-japonais toujours fécond aujourd’hui.
Modératrice : Yoko MIZUMA (LAREP, ENSP)
Organisation : IFRJ-MFJ
Co-organisation : Sciencescope, univ. de Chiba (IAAR), ENSP (LAREP)
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/15/2024-02-15_jardins_et_paysages/index.php
Fanon : race, genre et existence humaine sous domination coloniale
Vendredi 16 février / 18 h – 20 h
auditorium / conférence / en français avec traduction
Conférencière : Seloua LUSTE BOULBINA (univ. Paris-Cité)
Frantz Fanon (1925-1961), psychiatre, penseur, essayiste. Marqué par sa vie dans les marges de l’empire colonial d’alors qu’étaient la Martinique et l’Algérie, Fanon construit sa pensée sur son expérience de la société coloniale et sur sa pratique de psychiatrie en Algérie, aux côtés de laquelle il s’était engagé pendant la guerre d’indépendance. Son œuvre est également empreinte d’une profonde fréquentation de la pensée française des années 1940 et 1950. Seloua Luste Boulbina propose un portrait remis à jour de l’auteur qui a activement travaillé pour rompre le mutisme et redonner la voix aux colonisés. La portée critique de la pensée de Fanon fut immense et sa postérité internationale. Peut-être est-il temps de revisiter cet universaliste solitaire, alors que des facteurs démographiques, géopolitiques et de justice environnementale appellent une attention renouvelée à ce que l’on appelle désormais le Sud global.
Discutant : Satoshi UKAI (univ. Hitotsubashi)
Modérateur : Nao SAWADA (univ. Rikkyo, Fondation MFJ)
Organisation : IFRJ-MFJ, Comité d’invitation Seloua Luste Boulbina
Coopération : Fondation Maison franco-japonaise, JSPS Kakenhi (B) 20H04419
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/16/2024-02-16_seloua_luste_boulbi/index.php
Les rendez-vous du japonisme à la MFJ 2024
Jardins et paysages 3
Des estampes aux jardins : quand les regards des paysagistes japonais croisent ceux des paysagistes français
Lundi 10 février / 18 h – 20 h
hybride : salle 601 et en ligne / conférence / en français sans traduction
Conférencière : Yoko MIZUMA (LAREP, ENSP)
Au tournant du XXᵉ siècle, le japonisme se décline en France dans la plupart des domaines artistiques, dont l’art de l’aménagement des jardins. Les expositions universelles de Paris ont été de belles occasions pour les jardiniers-paysagistes français de découvrir les jardins du Japon, qui avaient aiguisé leur curiosité. À la même époque, au Japon, se produisait un phénomène similaire au japonisme français, mais en quelque sorte « inversé », le style occidental. Certains parcs et jardins réalisés à la fin du XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ siècle montrent ce que l’on pourrait appeler une conception formelle hybride, à la fois occidentale et japonaise. Cette intervention invite à (re)découvrir les influences réciproques franco-japonaises dans l’art des jardins en début du XXᵉ siècle, tout en mettant l’accent sur les croisements des regards des paysagistes sur le terrain au début du XXᵉ siècle.
*La conférencière résumera son exposé en japonais en fin d’intervention.
Modérateurs : Gilles MASTALSKI (CRCAO, LFI Tokyo), Sonia KERAVEL (LAREP, ENSP)
Organisation : IFRJ-MFJ
Co-organisation : Sciencescope, LFI Tokyo, univ. de Chiba (IAAR), ENSP (LAREP)
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/19/2024-02-19_jardins_et_paysages/index.php
Banking on Japan: why a sustainable future holds rich opportunities
Tuesday, February 20 / 12:30 – 14:00
hybrid: room 601 & online / Lunch seminar on Japanese economy and society /
in English without translation
Speaker: Bruno GAUSSORGUES (Representative Director, Group Country Head of Société Générale Japan)
Japan committed at the end of 2020 to net zero emissions by 2050. However, the country’s energy situation is extremely complex. It has the worst energy efficiency rate among major OECD countries, relies heavily on fossil fuels for power production, and enjoys no electricity interconnections with other countries. Additionally, there are few suitable sites in Japan for renewable energy production, while public opposition to nuclear power is considerable following the Fukushima nuclear disaster. To tackle these hurdles and achieve the 2050 net zero objective, the government has set-up a comprehensive and ambitious energy transition policy framework. Named the Green Transformation (GX), this set of policies aims to explore all dimensions of the energy transition, from electricity production and energy savings, to mobility. Bruno Gaussorgues will share insights on Japan’s energy transition.
Moderator: Raphaël LANGUILLON-AUSSEL (FRIJ-MFJ)
Organization: FRIJ-MFJ
Co-organization: CCI France-Japon
Support: French Embassy in Japan
Registration: https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/20/2024-02-20_ls_bruno_gaussorgue/index.php
Conférence du lauréat du Prix Shibusawa-Claudel (volet français), 39ᵉ édition
Routes maritimes et techniques de navigation des pirates japonais – seconde moitié du XIVᵉ – première moitié du XVᵉ siècle
Lundi 26 février / 18 h – 20 h
auditorium / conférence / en français avec traduction
Conférencier : Damien PELADAN (univ. Bordeaux Montaigne)
Entre 1350 et 1450, la mer de Chine orientale fut ébranlée par l’essor rapide d’une piraterie émanant de l’archipel japonais, connue dans l’historiographie japonaise sous le nom de wakō 倭寇, et qui à son apogée était en mesure de rassembler des centaines de navires pour se lancer à l’assaut des côtes coréennes et chinoises. Tirée de nos travaux de thèse, cette conférence portera un éclairage sur les techniques de navigation employées par ces pirates, en partant des pratiques générales employées par tous les marins de l’Asie orientale des XIᵉ – XVᵉ siècles (utilisation des vents et des courants, routes maritimes, technologies nautiques, etc.), pour ensuite distinguer les pratiques plus spécifiques aux flottes pirates.
Modérateur : Thomas GARCIN (IFRJ-MFJ)
Organisation : IFRJ-MFJ
Partenaires : Shibusawa Eiichi Memorial Foundation, univ. Teikyō
Coopération : Fondation MFJ, Fondation France-Japon de l’École des hautes études en sciences sociales
Parrainage : Ambassade de France au Japon, journal Yomiuri
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/26/2024-02-26_damien_peladan/index.php
Le mécanisme du shinsho japonais en évolution –
réflexion à travers l’histoire et le processus de fabrication
Mardi 27 février / 18 h – 20 h
hybride : salle 601 & en ligne / séminaire doctoral / en français sans traduction
Conférencière : Mai ONO (univ. Paris-Cité)
Cette thèse s’intéresse à la façon dont est produit et fonctionne le shinsho, ainsi qu’aux acteurs qui y sont impliqués. Il s’agit d’abord de d’expliciter l’histoire du shinsho depuis 1938 à travers le prisme du « kyōyō », un concept de culture générale. Ensuite, je tenterai de décrire et d’expliquer le fonctionnement du shinsho. Si, aujourd’hui, le shinsho est assez légitime pour être utilisé dans les examens d’entrée à l’université ou, tout simplement, pour se faire appeler comme « shinsho de kyōyō », on suppose qu’il existe un mécanisme qui permet de garder cette légitimité auprès du (grand) public. La structure de ce mécanisme serait à chercher, premièrement, dans le concept largement accepté par la société de « kyōyō », deuxièmement dans le tirage relativement élevé par rapport aux livres académiques et, enfin, dans les efforts des différents acteurs pour rendre les textes « compréhensibles ». L’objectif de la présentation serait donc de montrer ce mécanisme, comment celui-ci est construit dans le milieu du shinsho contemporain, et comment il est en train d’évoluer.
Modérateur : Pierre-Jean COLAS (Inalco)
Organisation : IFRJ-MFJ
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/27/2024-02-27_seminaire_doctoral/
Care et travail de care :
nouvelles questions au Japon et en France
Mercredi 28 février / 18h – 20h
auditorium / conférence / avec traduction simultanée
Conférencières : Sandra LAUGIER (univ. Paris 1, ISJPS), Yayo OKANO (univ. Doshisha)
L’éthique du care, en proposant de valoriser des valeurs morales d’abord identifiées comme féminines – le soin, l’attention à autrui, la sollicitude – a contribué à modifier une conception dominante de l’éthique. Elle place la vulnérabilité au cœur de la morale et implique aussi de se pencher sur tous ceux qui ont été blessés par des expériences violentes, celles des catastrophiques naturelles comme celles des atrocités humaines. Où en est, aujourd’hui, ce projet de société ? Comment le care permet de repenser des enjeux actuels tels que l’environnement et la sécurité ? Sandra Laugier et Yayo Okano partageront leurs points de vue sur ces questions dans le cadre d’une comparaison entre la France et le Japon.
Modératrice : Sophie HOUDART (IFRJ-MFJ)
Organisation : IFRJ-MFJ
Inscription : https://www.mfj.gr.jp/agenda/2024/02/28/2024-02-28_care/index.php
Diffusion sur Zoom
Certains de nos événements sont retransmis sur la plateforme Zoom. Un e-mail d’invitation sera envoyé à l’adresse indiquée lors de votre inscription, avec un identifiant et un mot de passe.
L’accès à ces manifestations est libre et gratuit (sauf mention contraire). Merci de vous inscrire sur la page Agenda de notre site web : https://www.mfj.gr.jp/agenda.
Diffusé par :
Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (IFRJ-MFJ)
Tous droits réservés : © 2024, IFRJ-MFJ